La science ressemble à la religion « comme le loup au chien »1 : dans leur ambition commune de rendre compte du monde, elles se sont livré une guerre sans partage. Il n’y a de place que pour l’une seule d’entre elles. Chaque progrès de la connaissance a ainsi été interprété, depuis les Lumières au moins, comme un recul de la foi. Cette thèse n’a rien d’original : c’est celle que défend notamment Bertrand Russell dans Science et religion2. Elle emporte pourtant un préjugé qui n’a rien d’évident : en remplaçant les dogmes de la foi, le discours scientifique répondrait aux mêmes questions, bien que différemment. Il serait ainsi un discours sur la réalité des choses. Nous sommes en droit d’avancer une hypothèse moins audacieuse : si la science et la religion semblent se contredire, c’est parce qu’on a justement voulu répondre aux questions de la foi dans les termes de la logique de la science, or la force de la science serait précisément de répondre à d’autres questions, rendant désuètes les anciennes interrogations de la théologie. La connaissance scientifique aurait donc pris la place de la religion par accident plus que par nature : alors que le lieu de l’explication métaphysique était laissé vacant dans le sillage du « désenchantement du monde »3, les esprits attachés aux vieilles questions y auraient installé le discours scientifique. Ils firent alors de la physique une métaphysique sans que rien, au sein du corpus scientifique, ne les y forçât pourtant. Je ne sais pas si cette explication résisterait à l’analyse historique – notre propos ne requiert de toute façon pas que l’on y consente. Elle illustre cependant une confusion coupable, d’ordre conceptuel, qui entache la science et que semble illustrer sa guerre contre la religion : la science n’est pas un discours du même ordre que la foi et il ne peut pas, en particulier, dire la réalité des choses. Attachons-nous à le démontrer.
L’une des avancées les plus décisives de l’épistémologie du XXe siècle est probablement la prise de conscience de la sous-détermination des théories scientifiques par l’expérience. Si Pierre Duhem, physicien français brillant mais notoirement antisémite, est le premier à esquisser cette thèse dans La théorie physique : son objet, sa structure4, c’est à Willard von Orman Quine que l’on doit de l’avoir pleinement explorée – d’abord en la présentant sous sa forme la plus radicale dans le fameux article sur les « Deux dogmes de l’empirisme »5, puis en l’atténuant sans en émousser toutefois la force critique dans un article ultérieur « Sur les systèmes du monde empiriquement équivalents »6.
L’idée battue en brèche par ces auteurs est la possibilité, que l’on tend à accepter intuitivement, de tester isolément une hypothèse. Prenons un exemple. La Terre tourne-t-elle sur elle-même, expliquant la succession des jours et des nuits, ou bien reste-t-elle immobile et c’est le soleil qui lui tourne autour ? Le physicien français Léon Foucault a mis au point une expérience célèbre permettant de trancher entre ces deux théories : il suffit, explique-t-il, de lâcher un pendule dans le vide et de regarder son plan d’oscillation. Livré à lui-même, le pendule va en effet conserver son plan d’oscillation indépendamment de la Terre en-dessous de lui : si ce plan reste le même par rapport à notre planète, c’est qu’elle est immobile, mais si elle bouge, alors ce plan semblera se déplacer subtilement. L’expérience, qui n’a rien d’aisé techniquement car il faut pouvoir maintenir longtemps le pendule en mouvement pour espérer déceler une modification du plan d’oscillation, a été réalisée en 1851 sous la coupole du Panthéon. Elle mit en évidence la déviation constante du plan d’oscillation du pendule, démontrant que la Terre en dessous de lui se meut, et donc qu’elle tourne. Cela semble invalider la théorie de l’immobilité terrestre. Schématiquement, de la théorie T : « La Terre est immobile », on peut déduire la prévision p : « Le plan d’oscillation d’un pendule au-dessus de la Terre ne déviera pas au fil du temps ». En menant l’expérience, on s’aperçoit toutefois que p est faux, ce qui invalide T.
Est-on cependant sûr que T est fausse ? L’expérience du pendule est en effet, du point de vue de l’immobiliste, un échec : elle semble indiquer que non-T est vrai, mais rien ne nous permet logiquement de l’affirmer. Il se pourrait fort bien par exemple que la théorie newtonienne du mouvement soit fausse, et que l’invariance du plan d’oscillation d’un pendule dans un référentiel galiléen soit une erreur. Plus radicalement, on pourrait argumenter que nous sommes tous victimes d’une hallucination collective ou qu’un biais de nos organes perceptifs conduirait à fausser notre vision du monde, si bien que le plan d’oscillation ne dévie que dans nos têtes. Ces hypothèses peuvent paraître audacieuses, mais du point de vue logique, elles sont aussi valables que celle soutenant la fausseté de T. On ne teste pas T isolément, car notre expérience implique une foule d’autres théories.
En réalité, p n’est pas déduite de T seule, mais de T ET de l’ensemble de nos théories physiques existantes ET d’une foule d’hypothèses implicites relatives, notamment, à notre perception du monde ou aux lois de la logique qui semblent en régir le cours. Tout à fait logiquement, donc, on ne déduit pas p de T mais d’une conjonction de T et de nombreuses théories d’arrière-plan : l’invalidation de p ne conduit donc pas à l’invalidation de T, mais à l’invalidation d’une proposition au sein de cette conjonction sans que nous soyons forcés de conclure qu’il s’agisse bel et bien de T.
Formalisons le propos. Si j’appelle B l’ensemble des théories d’arrière-plan qui me permettent de déduire p (B est elle-même une conjonction de théories, relatives à la physique, à la logique, à nos perceptions, etc.), on a alors la déduction suivante qui est un modus tollens7 :
T ∧ B ⇒ p , ¬ p¬ (T ∧ B)
Cela nous conduit à déduire, lorsqu’on développe : ¬ T ∨ ¬ B. T et B peuvent être fausses en même temps, T peut être seule fausse ou bien B seulement, mais rien ne permet de choisir entre les trois branches de cette alternative, au point de vue logique à tout le moins.
Ce qu’affirme Duhem, et Quine après lui, c’est que toute expérimentation exige, pour être réalisée, une multitude de théories d’arrière-plan relatives à nos outils de mesure, à notre cadre conceptuel, à nos facultés perceptives ou encore au monde lui-même. On ne teste jamais une hypothèse seule, mais un ensemble de théories. « En résumé, écrit Pierre Duhem, le physicien ne peut jamais soumettre au contrôle de l’expérience une hypothèse isolée, mais seulement tout un ensemble d’hypothèses ; lorsque l’expérience est en désaccord avec ses prévisions, elle lui apprend que l’une au moins des hypothèses qui constituent cet ensemble est inacceptable et doit être modifiée ; mais elle ne lui désigne pas celle qui doit être changée. »8 On appelle cette thèse le holisme épistémologique.
Duhem défend le holisme s’agissant de la théorie physique. Le Quine des « Deux dogmes … » soutient qu’il s’applique en réalité à l’ensemble de notre connaissance, jusques et y compris la logique et les connaissances les plus abstraites et les plus fondamentales. Pour lui, c’est toujours la science dans son ensemble qui est testée à chaque expérience : « nos énoncés sur le monde extérieur affrontent le tribunal de l’expérience sensible, non pas individuellement, mais seulement collectivement »9. Rien n’oblige en effet de restreindre la thèse de Duhem à la seule physique, rien ne nous y oblige logiquement.
Une fois bien comprise, l’hypothèse holiste semble logiquement assez imparable. Ses conséquences sont pourtant profondes. Elle implique d’abord qu’il est toujours possible de rendre vrai un énoncé quelconque. Dans notre exemple, si nous tenons absolument à vérifier T, il est tout à fait envisageable de dire que la fausseté est portée par (un pan de) B. Cela conduira sans doute à remettre en cause beaucoup de connaissances tenues pour acquises, mais moyennant ces corrections drastiques, il sera toujours possible de sauver la vérité de T. Le « coût épistémique » d’une telle entreprise, si l’on accepte d’appeler ainsi l’ampleur du travail consistant à reformuler nos théories B pour rendre T ∧ B vrai relativement à l’expérience menée sans toucher à T, peut toutefois s’avérer colossal, ce qui nous dissuade de céder à de tels excès. C’est pourtant ce qu’on a fait parfois en physique quantique : on a préféré abandonner le principe du tiers exclu pour accepter la superposition, ou le principe de localité pour rendre compte de l’intrication. Il a alors semblé plus judicieux, ou plus économique, de modifier des théories plus éloignées de l’expérience. Il existe donc des arguments pratiques, économiques ou heuristiques de préférer abandonner une hypothèse plutôt qu’une autre, et cette tendance générale nous pousse à remettre plus facilement en cause les propositions les plus proches de l’expérience et les plus particulières – mais ces arguments ne sont jamais logiquement nécessaires. À la limite, rien ne nous interdit de dire que la Terre est plate, pour peu que l’on aménage d’une façon ou d’une autre l’ensemble de notre système de connaissances pour rendre vraie cette affirmation, ce qui est toujours possible en droit, même si cela est rarement souhaitable en fait.
Il découle de ces considérations que notre système de connaissance actuel n’est qu’une théorie possible parmi une infinité d’autres qui décrivent exactement les mêmes phénomènes physiques. On pourrait en effet en modifier un pan et, en réaménageant le reste des théories, obtenir une nouvelle description du monde tout autant valide et pourtant totalement incompatible avec la première. On peut imaginer une infinité de courbes passant par une infinité dénombrable de points ; de la même manière, une infinité de théories sont possibles, qui collent à la réalité dans l’ensemble des observations que l’on pourra réaliser. La connaissance est une cotte mal taillée n’épousant qu’imparfaitement la réalité : les faits sous-déterminent nos théories. Il est possible d’imaginer plusieurs « systèmes du monde empiriquement équivalents », c’est-à-dire plusieurs ensembles théoriques rendant compte des mêmes observations, ce qui paraît relativiser profondément la réalité de nos théories.
Une autre conséquence du holisme est la ruine de la distinction entre l’analyse et la synthèse. La tradition, à la suite de Hume, Leibniz puis Kant, distingue en effet les propositions analytiques, vraies dans tous les mondes possibles, c’est-à-dire universelles et tautologiques (par exemple : « les célibataires sont des personnes non mariées »), et les propositions synthétiques, qui lient entre eux deux concepts indépendants (par exemple : « le paracétamol fait baisser la fièvre »). Si Kant a cru pouvoir établir l’existence de propositions synthétiques indépendantes de l’expérience, les empiristes, y compris logiques, ont rapidement assimilé les énoncés analytiques à des énoncés logiques et mathématiques indépendants de l’expérience, et les énoncés synthétiques à des énoncés portant sur le monde. L’analyticité devint alors le domaine d’un travail déconnecté du réel, purement formel, de décomposition des concepts. La thèse holiste nous permet cependant de rendre fausse toute proposition tenue pour vraie jusqu’alors – il suffit simplement de réaménager notre système de connaissances. En conséquence, la classe des énoncés analytiques se réduit à l’ensemble vide puisqu’un énoncé analytique est par définition un énoncé qui résiste éternellement à l’invalidation. Il n’existe que des énoncés synthétiques. Cela signifie que toute connaissance est empirique, non pas au sens où elle serait expérimentale, mais au sens où elle dépend des points de contact que notre corpus théorique entretient avec la réalité. Toute connaissance, y compris la logique ou les mathématiques.
Le holisme a donc une conséquence simple mais destructrice : puisqu’il n’existe pas d’expérience cruciale, alors tout est permis – au moins du point de vue logique. Il nous faut d’emblée en déduire que le réalisme scientifique, c’est-à-dire la doctrine qui tient pour réels les objets de nos théories scientifiques, est intenable, tant ces théories nous apparaissent comme logiquement contingentes. On le voit, la puissance de cette thèse est considérable. Elle nous offre pourtant l’opportunité de reconquérir une épistémologie plus humaine.
Il est assez évident que les choses sont telles qu’on en fait l’expérience10. Il ne s’agit pas là de soutenir que l’expérience nous permettrait de les connaitre telles qu’elles sont, car cela est évidemment faux : nous pouvons souffrir d’illusions ou ignorer certaines propriétés des choses que se dévoilent. Je crois cependant que l’expérience n’est pas tout entière cognitive : il y a dans l’expérience quelque chose d’a-normal, qui échappe à la raison et à la sensation, si ce dernier mot désigne un stimulus déjà conceptuel permettant de fonder nos savoirs, sans toutefois échapper à l’expérience. On peut décrire scientifiquement la capacité des insectes à percevoir les rayonnements ultraviolets mais même la description la plus fine ne nous dira jamais l’effet que cela fait11 de voir des ultraviolets. Dans l’expérience, indépendamment de la connaissance, les choses se présentent donc telles qu’elles sont.
Cette évidence a toutefois été largement masquée par le développement de la physique moderne. Par un curieux retournement, nous avons aujourd’hui tendance à croire que les atomes inobservables qui composent la table sont en effet plus réels que la table elle-même. On comprend en partie pourquoi : en référant à la structure mécanique de la table, je semble la comprendre davantage. L’analyse physique pourrait en effet me permettre de déceler des faiblesses dans sa constitution, et de savoir avant même de poser un vase sur ma table que celle-ci va s’effondrer en raison d’un défaut de construction. Ce défaut ne saute pas aux yeux ; il existe pourtant. Parce qu’elle permet des prévisions plus fines de ce qui va advenir, ce que l’on pourrait appeler la « conception scientifique de la table » nous apparaît donc plus vraie que l’expérience naïve et immédiate que je fais de ma table. Il s’agit cependant là d’une confusion coupable entre, d’une part, le pouvoir prédictif d’une idée et, d’autre part, sa réalité. Lue à travers le prisme du holisme, cette confusion ne tient plus : si la conception scientifique de la table est plus efficace lorsqu’il s’agit d’appréhender les conséquences à venir de nos comportements, elle reste, en tant que conception théorique, purement contingente. En l’espèce, une autre conception scientifique de ma table, empiriquement équivalente, me permettrait de parvenir aux mêmes prévisions en me livrant une image tout à fait différente de ma table. À l’évidence, donc, cette conception scientifique ne peut être tenue pour un discours sur la réalité de ma table.
Cela a au moins le mérite de remettre à sa juste place le discours scientifique, dans lequel la logique et les mathématiques sont naturellement incluses : celle d’un instrument, issu de l’expérience immédiate, qui doit permettre de mieux appréhender l’expérience elle-même afin d’y évoluer plus efficacement. La sous-détermination des théories par l’expérience permet, par la variété des théories incompatibles qu’elle autorise, de ruiner les prétentions de ces théories à la réalité. L’anéantissement des énoncés analytiques permet, quant à lui, de démontrer que cette ruine touche l’ensemble du savoir, jusques et y compris la logique la plus fondamentale. À cette aune, les atomes n’existent pas, en tout cas pas au sens de cette table dont je fais l’expérience, car je ne fais pas l’expérience d’un atome ; et pourtant les atomes ne sont pas dénués de sens, en ceci qu’ils permettent de prévoir les expériences que je pourrais avoir. Ils sont, comme l’expliquait déjà Quine dans les « Deux dogmes … », des entités postulées « comparables, épistémologiquement parlant, aux dieux d’Homère »12, bien que leur pouvoir explicatif soit probablement beaucoup plus grand. Un décalage est alors conquis au fil de l’argument : la science ne vaut pas en elle-même ; elle tire sa valeur des possibles qu’elle ouvre. En un mot, ce n’est pas la connaissance objective permise par la science qui importe, mais ses fruits pour la société et le progrès du genre humain.
À la fin d’Expérience, Ralph Waldo Emerson écrivait : « Je sais que le monde avec lequel je parle dans la ville et dans les fermes n’est pas le monde que je pense. »13 Sidérés par l’illusion d’une connaissance objective, nous avons perdu de vue l’intimité du savoir et du pouvoir, de la connaissance et de l’action. Nous avons défait les liens qui les unissaient, croyant parvenir à des certitudes d’autant plus précieuses qu’elles échappaient à l’impureté du réel. Ce dualisme originel est père de tous nos maux. Juchés sur ces « hauts lieux fortifiés par la pensée des sages » dont parlait déjà Lucrèce dans son De Natura rerum, toisant « au loin le reste des hommes, qui errent çà et là en cherchant au hasard le chemin de la vie »14, nous avons refusé de voir la réalité en face : les progrès des sciences ont ainsi largement engendré les malheurs des hommes. La révolution industrielle a vu se lever une cohorte de pauvres, d’exténués, de déshérités qui aspiraient à vivre libres15, et le développement technique a trouvé son illustration la plus aboutie dans les massacres des deux guerres. Nous avons ignoré qu’en définitive, c’est l’expérience qui auréole la connaissance de sa valeur, parce que nous héritions d’une mentalité sens dessus dessous : l’action était moins vraie que la contemplation. Le holisme a donc une vertu thérapeutique : comme l’amputation, il guérit le malade en le privant de ce qui lui est cher ; en l’occurrence, en ruinant la certitude théorique, rassurante mais impuissante, il nous réconcilie avec la pratique, qui seule vaut à la fin. En remettant l’expérience en avant, la connaissance renoue avec l’action, comme en écho à la prophétie d’Emerson : « le roman vrai que le monde existe pour réaliser sera la transformation du génie en pouvoir pratique. »16
- Platon, Le Sophiste, 231a. [↩]
- Bertrand Russel, Science et religion, trad. fr. Philippe-Roger Mantoux, Paris : Gallimard, 1971 (1935). [↩]
- L’expression est de Max Weber. Elle a été popularisée et élargie par les travaux de Marcel Gauchet : Le désenchantement du monde : une histoire politique de la religion, Paris : Gallimard, 1985. [↩]
- Pierre Duhem, La théorie physique : son objet, sa structure, Paris : Vrin, 2007 [1906]. [↩]
- Willard von Orman Quine, « Deux dogmes de l’empirisme », Du point de vue logique : neuf essais logico-philosophiques, trad. fr. Sandra Laugier et al., Paris : Vrin, 2003, p. 49-81 [1953 pour l’ouvrage anglais, 1951 pour l’article]. [↩]
- Willard von Orman Quine, « Sur les systèmes du monde empiriquement équivalents », trad. fr. Sophie Hutin et Sandra Laugier, Philosophie des sciences : naturalisme et réalisme, tome II, Paris : Vrin, 2004 p. 114-138 [1975]. [↩]
- Le formalisme logique peut sembler aride, mais il est simple en réalité : ∧ représente la conjonction logique, c’est-à-dire le « et » ; ∨ représente la disjonction logique, c’est-à-dire le « ou » ; ¬ représente la négation, donc ¬ A est vrai si A est faux ; et enfin ⇒ représente l’implication logique, ainsi « A ⇒ B » se lit « A implique B » et n’est faux que si B et vrai et A est faux. Ce qui est formellement écrit, c’est qu’à partir du fait que T et B implique p d’une part, et que non-p est vrai d’autre part, on déduit non (T et B). On sait par ailleurs que non (T et B) est logiquement équivalent à (non T) ou (non B) ; il s’agit des lois de De Morgan. Si vous en doutez, vérifiez-le par vous-même ! La proposition « il ne fait pas beau et chaud » est par exemple équivalente, logiquement, à la proposition « il ne fait pas beau ou il ne fait pas chaud ». [↩]
- Duhem, op. cit., p. 262. [↩]
- Quine, « Deux dogmes de l’empirisme », op. cit., p. 75. [↩]
- John Dewey, « Le postulat de l’empirisme immédiat », L’influence de Darwin sur la philosophie, et autres essais de philosophie contemporaine, trad. fr. Claude Gautier, Stéphane Madelrieux et al., Paris : Gallimard, 2016, p. 199-211 [1905]. [↩]
- Voir notamment : Thomas Nagel, « Quel effet cela fait-il d’être une chauve-souris ? », Questions mortelles, trad. fr. Pascal Engel, Paris : Presses universitaires de France, 1983, p. 193-209 [1974]. [↩]
- Quine, « Deux dogmes de l’empirisme », op. cit., p. 79. [↩]
- Ralph Waldo Emerson, « Expérience », Qu’est-ce que la philosophie américaine, trad. fr. Christian Fournier et Sandra Laugier, Paris : Gallimard, 2009, p. 527 [1844]. [↩]
- Lucrèce, De la nature, trad. fr. Alfred Ernout, Paris : Les belles lettres, 1920. [↩]
- Je reprends ici les mots du célèbre poème d’Emma Lazarus, « Le nouveau colosse ». [↩]
- Emerson, op. cit., p. 527. [↩]
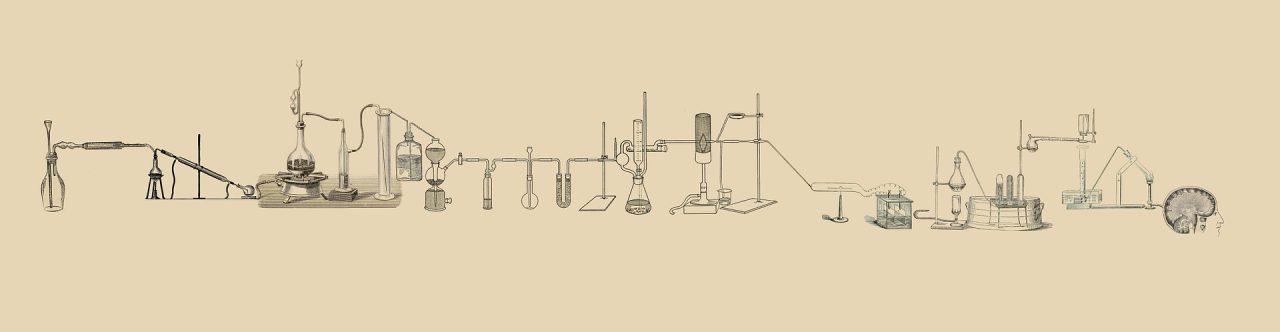
Laisser un commentaire