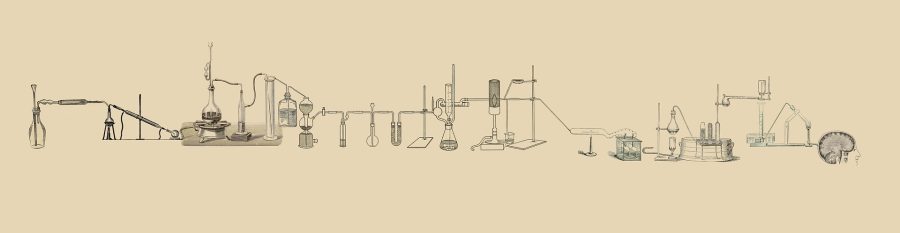La science ressemble à la religion « comme le loup au chien »1 : dans leur ambition commune de rendre compte du monde, elles se sont livrées une guerre sans partage. Il n’y a de place que pour l’une seule d’entre elles. Chaque progrès de la connaissance a ainsi été interprété, depuis les Lumières au moins, comme un recul de la foi. Cette thèse n’a rien d’original : c’est celle que défend notamment Bertrand Russell dans Science et religion2. Elle emporte pourtant un préjugé qui n’a rien d’évident : en remplaçant les dogmes de la foi, le discours scientifique répondrait aux mêmes questions, bien que différemment. Il serait ainsi un discours sur la réalité des choses. Nous sommes en droit d’avancer une hypothèse moins audacieuse : si la science et la religion semblent se contredire, c’est parce qu’on a justement voulu répondre aux questions de la foi dans les termes de la logique de la science, or la force de la science serait précisément de répondre à d’autres questions, rendant désuètes les anciennes interrogations de la théologie. La connaissance scientifique aurait donc pris la place de la religion par accident plus que par nature : alors que le lieu de l’explication métaphysique était laissé vacant dans le sillage du « désenchantement du monde »3, les esprits attachés aux vieilles questions y auraient installé le discours scientifique. Ils firent alors de la physique une métaphysique sans que rien, au sein du corpus scientifique, ne les y forçât pourtant. Je ne sais pas si cette explication résisterait à l’analyse historique – notre propos ne requiert de toute façon pas que l’on y consente. Elle illustre cependant une confusion coupable, d’ordre conceptuel, qui entache la science et que semble illustrer sa guerre contre la religion : la science n’est pas un discours du même ordre que la foi et il ne peut pas, en particulier, dire la réalité des choses. Attachons-nous à le démontrer.
- Platon, Le Sophiste, 231a. [↩]
- Bertrand Russel, Science et religion, trad. fr. Philippe-Roger Mantoux, Paris : Gallimard, 1971 (1935). [↩]
- L’expression est de Max Weber. Elle a été popularisée et élargie par les travaux de Marcel Gauchet : Le désenchantement du monde : une histoire politique de la religion, Paris : Gallimard, 1985. [↩]