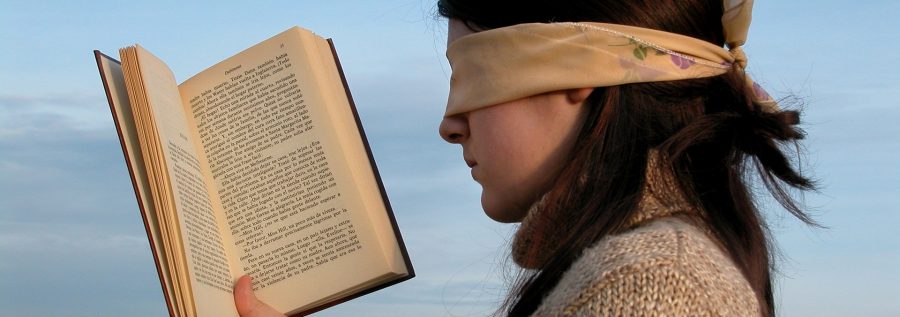Il est commun de dépeindre l’histoire de l’enseignement comme le passage d’une éducation traditionnelle, centrée sur le professeur et la transmission de connaissances par l’imitation et un recours accru à la mémoire, à une éducation moderne, centrée sur l’élève et l’individualité, laissant un large espace à la pratique et à l’activité. Bien que simplificatrice, cette approche permet de mettre en lumière le tréfonds intellectuel (ou idéologique) qui justifie cette évolution.
En retraçant très rapidement les grands moments de cette transition, nous entendons mettre en lumière ses deux mouvements intimes, qui puisent leur source dans la révolution scientifique : le passage d’une vision qui asservit l’individu au tout de la société à une vision qui consacre l’individualité comme source de la connaissance ; un changement de regard sur les connaissances elles-mêmes, non plus héritées du passé, mais construites par l’expérimentation active. Ce mouvement peut globalement être interprété comme un passage de l’hétéronomie (politique et épistémologique) à l’autonomie, cette dernière constituant comme le vit Kant la clé des Lumières.
L’enjeu de cet article sera alors de montrer que ce passage a été trop radical sur la plan politique, et trop peu sur le plan épistémologique, ce qui appelle un rééquilibrage. Ce rééquilibrage, nous pensons pouvoir le trouver dans la pédagogie de John Dewey qui, loin de s’inscrire naïvement dans le mouvement de la modernité, en corrige bien plutôt les excès en livrant, dans une veine pragmatiste, (a) une vision socialisée et expérientielle de l’individu, en recul par rapport à l’autonomisation excessive de la modernité, et (b) une théorie des idées comme plans d’action, et donc de la vérité comme contextuelle, en rupture avec la conception des idées-reflets que la modernité a reconduit sans autre forme de procès.